Premier texte signé Claudie Létourneau de la série Textes des membres de Rhizome.
Quelque chose est mort en même temps que François Blais
J’ai toujours eu une curiosité pour la vie d’autrui. Il n’y a rien de plus satisfaisant que de passer devant un immeuble à logements, à la noirceur, et d’observer en cachette toutes ces vies menées parallèlement à la mienne. Ce n’est pas la décoration ni la disposition du mobilier dans les foyers qui capte mon attention, mais, étrangement, quelque chose d’encore plus ordinaire : le quotidien. Coupe de vin qui s’éternise à table, film collé en amoureux ou préparation de plats pour le lendemain, ce que font les gens lorsque personne ne les regarde reste, sans aucun doute, l’un de mes intérêts les moins avouables.
Ma fascination pour la vie ordinaire a commencé lors d’une lecture obligatoire dans un cours au baccalauréat en études littéraires. Bienvenue au pays de la vie ordinaire de Mathieu Bélisle était au programme. Immédiatement, les références indiscrètes aux cérémonies du dimanche soir devant Tout le monde en parle m’ont fait rire. Je ne me rappelle pas un temps où ma famille et moi ne nous asseyions pas devant la télévision pour notre messe hebdomadaire. J’ai très peu de souvenirs de moments où échanger à propos d’enjeux importants était permis autrement que pendant les pauses publicitaires de cette soirée dominicale. La seule exception est mon souvenir familial préféré. Nous sommes en 2008, dans la salle à manger chez mes parents, mon beau-père et ma grand-mère argumentent à propos de leurs penchants politiques respectifs. « Moi, je vote pour la personne, pas pour le parti, tonne mon beau-père. On peut dire ce qu’on veut de Mario Dumont, mais il n’a pas de limite dans ses opinions et c’est un gars franc et transparent. C’est pour ces valeurs-là que je vote. » C’est du regard désapprobateur de ma grand-mère que je me rappelle le plus. Les bras croisés sur la table, elle secoue la tête avant de donner à son gendre sa façon de penser. À leur insu, ils ouvrent en moi l’envie de débattre et de défendre ce qui me tient à cœur. À neuf ans, ils croyaient probablement que je ne comprenais pas à quoi faisaient référence le bleu et le rouge. J’en ris encore.
Mon intérêt envers le quotidien n’a cessé de croître depuis. Dans mes temps libres, j’enchaîne lectures d’essais et recherches qui me permettront enfin de saisir ce qui m’intrigue autant à propos de la lourdeur de la routine. Une explication à ma vie ordinaire qui ne m’apporte aucun réconfort, en ce moment, dans la mi-vingtaine. Ce désir constant de détendre l’atmosphère, de ne surtout jamais déranger les autres avec mon point de vue et mes émotions m’a toujours donné l’impression de devoir performer en toutes circonstances. Comme s’il n’était possible de retirer le masque porté en public qu’une fois la porte fermée. Les sujets engagés pouvant amener des différends et donc, briser les apparences, sont ainsi évités, de peur de partager son opinion ou, plus inquiétant encore, son absence d’opinion.
Un jour, frustrée de mes suppositions qui ne m’apportaient aucune réponse satisfaisante, je m’abandonne à la lecture du roman Document 1 de François Blais. Je ris à haute voix, je partage des passages à mes ami·es. Je suis transportée dans ce récit de voyage qui n’en est pas vraiment un. Je m’identifie aux personnages. Leur fatigue, leur lucidité, leur mode de vie déglingué : tout est si vrai et sans filtre. Je sens que je tiens enfin quelque chose.
Quelques mois plus tard, parmi les recommandations de Babelio que j’ignore d’ordinaire religieusement, le titre Iphigénie en Haute-Ville, du même auteur, retient mon attention. L’été arrive : j’ai envie de romance et de légèreté. La quatrième de couverture m’annonce déjà que l’histoire, celle d’un couple, finira mal. Enchantée, je suis immédiatement interpellée par ce livre qui ne me racontera pas de sottises pendant deux cents pages. En le refermant, je sais que je ne garderai pas ce goût amer d’une vision idéalisée de l’amour qu’on essaiera de me faire avaler de force. J’y reconnais le même ton humoristique, mais trash, qui m’avait tant conquise la première fois. Un humour qui n’épargne rien ni personne, qui ne craint pas de dire tout haut ce que ses lecteur·rices pensent tout bas. « La vie n’a pas de sens ? Big fucking deal ! 1» peut-on lire dans les premières pages du livre. S’amorce alors ma deuxième lecture d’un roman de François Blais.
Au mois d’avril, j’amène mon exemplaire écorché d’Iphigénie en Haute-Ville au Salon du livre de Québec. J’ai plusieurs dizaines de minutes d’avance, rôdant comme un charognard autour du kiosque de L’Instant même. Je tourne en rond, comme si je me tenais là par hasard, jusqu’à ce qu’il arrive. Gênée, je sors ma copie remplie de post-it et de surligneur pour qu’il m’écrive un mot d’encouragement. Un message pour mon mémoire, plus précisément, que je ne rédige pas encore à ce moment-là, mais qui porte sur deux de ses œuvres. Une recherche qui m’apportera peut-être les réponses dont j’ai besoin. Ça l’intéresse ; il me demande de lui envoyer lorsque ce sera terminé.
« Pour Claudie,
Bonne chance pour ton mémoire sur le cynisme, et merci d’apprécier mon roman le plus mauvais
François »
Je lui avoue que je vois en ses œuvres une grande noirceur, mais qu’elle ne m’effraie pas : digeste, car abordée avec humour et transparence, elle me donne envie de la comprendre et de la disséquer. Il acquiesce, embarrassé que deux de ses livres soient les principaux objets de mes recherches pour les deux prochaines années. Je suppose qu’il a l’habitude d’être complimenté sur ses blagues surprenantes plutôt que sur son cynisme et sa lucidité.
Lorsque je retourne auprès de mon copain, mes mains tremblent encore et j’ai chaud. Je lui raconte notre échange : que je lui ai partagé le sujet de ma recherche, qu’il avait l’air d’accord que notre société souffrait d’un mal insaisissable, mais ô combien présent. « J’espère ne pas l’avoir mis mal à l’aise, mais c’est que j’avais tellement hâte de lui parler. » « Si ça peut te rassurer, il avait l’air aussi gêné que toi. Il se triturait les mains sous la table pendant que vous parliez. », me confirme mon chum. Voyant que je suis encore inquiète à l’idée d’avoir traumatisé mon auteur préféré en pointant la souffrance que sous-tendent ses œuvres, il ajoute : « Il a seulement parlé quelques secondes avec le gars après toi. Votre conversation devait vraiment l’intéresser. »
Sans même l’avoir adressé, je sens que François comprend mon malaise et mes recherches qui en découlent. Si la lecture de ses œuvres m’est quasiment thérapeutique, je me doute que, de son côté, c’est l’écriture qui lui permet de saisir un peu mieux ce mal-être qui l’habite. La lucidité de ses personnages et du regard qu’ils jettent sur le monde me donne l’occasion de reprendre mon souffle après une journée à performer dans le théâtre qu’est l’existence. Comme ses protagonistes, j’ai moi aussi l’impression de devoir me prêter au jeu de la vie. De devoir construire un autre Moi qui soit plus souriant, plus heureux et moins désabusé. À leur façon, les personnages de François mènent eux aussi une existence-alibi, une vie de façade, comme s’ils « traversai[ent] la vie avec un visa de tourisme2 ».
Sa dédicace auto dépréciative dans mon livre, son malaise évident en entrevue et sa volonté de se tenir à distance du monde3 me laissent croire qu’il possède tous les qualificatifs pour être un personnage d’un de ses romans4. C’est peut-être grâce à eux s’il peut exister pleinement, puisque protégé par le mur de la fiction. Le fait de pouvoir changer d’identité chaque fois qu’il ouvre son document Word lui laisse assurément plus de latitude pour partager son opinion et ses pensées les plus intimes. C’est lorsque je lis les mots de Tess, Jude, Iphigénie et Érostrate que je me sens la plus proche de lui, plus qu’au moment de notre rencontre au Salon du livre. Même s’il ne se souviendra peut-être pas de moi, j’ai, de mon côté, développé un lien particulier avec lui à travers ses livres. La vie — ou la littérature — est parfois drôlement faite.
Un mois plus tard, j’apprends son décès. Son suicide. Je ne trouve pas les mots lorsque mon entourage me transmet son soutien. À la maison, ses livres me hantent. Je sais qu’ils sont là, classés par couleur. Je ne les regarde pas et passe tout droit. Le déni dure des semaines, mais je n’ai pas le choix de me replonger dans la rédaction du mémoire. La remise au travail est graduelle. J’alterne le défrichage de ses œuvres avec le visionnement d’entrevues qu’il a données. « Tu viens d’écrire un roman, c’est déjà genre 50 000 mots, t’as-tu besoin d’en rajouter pour expliquer ce que tu viens de dire ?5 », lance-t-il nonchalamment au journaliste, comme si ses livres contenaient toutes les réponses que j’attendais. Peut-être a-t-il raison. J’arrive à écrire quelques pages de mémoire.
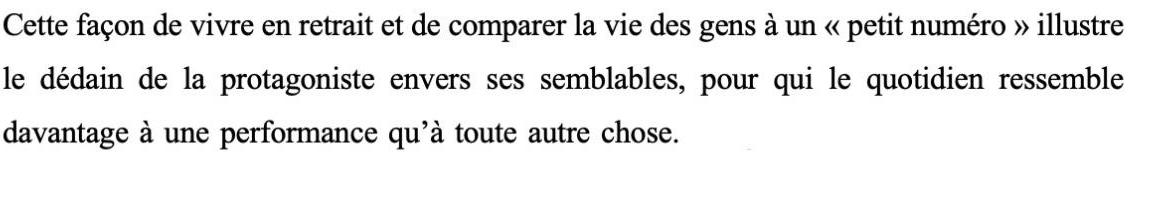
La frontière se floute entre ses personnages, lui et moi. La lecture de ses œuvres était le remède à mon nihilisme, qui trouvait refuge auprès d’autres incompris. Je voyais mes idées noires prendre vie sur les pages comme si j’étais celle qui les avait remplies : « il nous semble inconcevable, à nous qui sommes allés sur la Lune, nous qui avons écrit l’Odyssée et Hamlet, nous qui avons inventé la poudre à canon, Internet et la rôtissoire verticale, que notre existence ait la même finalité que celle du marsouin et de la crevette.6 » Mais celui qui leur donnait vie s’est enlevé la sienne. Lorsque j’aurai terminé la lecture de toutes les œuvres de François, j’aurai possiblement fait le tour de toutes mes échappatoires. Je devrai alors pleinement jouer le jeu moi aussi.
Ce qui me pousse enfin à continuer mon mémoire, c’est cette impression de toucher à bien plus que la littérature québécoise. Le malaise auquel je m’attarde est loin d’être fictionnel : depuis le quatrième siècle avant Jésus-Christ, Diogène nous parle de remuer les lieux communs en arrachant les masques et en dénonçant les supercheries7. Je me dois de poursuivre ce travail que François a déjà si bien amorcé.
À force de me retrouver, chaque soir, toujours aussi triste que la veille, mon copain s’inquiète. Je lui confie ne pas penser au suicide au sens où je veux passer à l’acte, mais plutôt qu’il n’y a pas une journée qui passe sans que j’aie une pensée pour cette finalité ou pour les personnes l’ayant choisi. Je lis tellement de récits à propos de crise existentielle que j’en viens à assimiler ce sentiment de déception et de désillusion face à l’existence. En fait, celui-ci est déjà en moi et se nourrit de mes lectures comme un bébé au sein. Je trouve confrontant que l’auteur dans lequel je me reconnais le plus s’enlève la vie. La plongée sensible dans ses œuvres de fiction m’a donné l’impression d’accéder aux recoins les mieux gardés et les plus francs de son cerveau en souffrance. Maintenant, son départ m’amène à me questionner sur mon propre rapport à la vie. Comme si, parce que je me sens enfin comprise par quelqu’un, et que cette personne disparaît, je suis vouée à mourir moi aussi. Pendant plusieurs semaines, j’appréhende chacun des événements majeurs de ma vie avec un intérêt morbide : « Est-ce que c’est ça qui va finir par m’achever ? »
Antidépresseurs. Suivis réguliers chez le médecin. Augmentation de la dose de citalopram. Une, deux, trois, quatre fois. On me conseille de faire ce que j’aime, mais je ne sais plus ce que cela veut dire.
Je me sens trahie, François. Je pensais que mettre en scène ta désillusion, c’était ton moyen de la contrer. Que tu te permettais de faire vivre et dire à tes personnages ce que tu pensais, comme ça, peut-être que ça allait passer. Mais ce n’était pas assez, hein ? J’ai peur que ça ne soit plus assez pour moi non plus.
N’arrivant plus à me sortir la tête hors de l’eau par mes propres moyens, je propose à une amie de prendre rendez-vous avec une voyante. J’ai envie que quelqu’un me dise ce qui s’en vient pour moi. J’ai besoin de savoir que des événements, bons ou mauvais, ont seulement la possibilité de survenir. Mon amie nous dégote celle que tout le monde surnomme « la sorcière », parce qu’en plus de lire l’avenir, elle entre en communication avec les morts. Instinctivement, je me dis que s’il devait y avoir quelqu’un avec moi dans la pièce, ce jour-là, ce serait François. Je dis bien si, car quelque chose me dit que la sorcière ne lui inspirerait pas confiance. Je l’entends presque me dire : « la question à cent piastres c’est : comment une personne si bien avertie de l’avenir peut-elle résister à l’envie de se pendre ?8 »
Un brin d’espoir jaillit cependant au mois de mars 2023, moment où se tiennent des journées d’étude lui étant entièrement consacrées. Des gens de tous les coins du Québec se réunissent pour échanger sur son œuvre et sur lui ; j’en fais partie. Lors du deuxième après-midi, je déduis, à l’attention qu’on leur porte, que des proches de la famille de François viennent assister à quelques lectures et présentations. Assis·es devant moi, les yeux mouillés, je les devine ému·es de constater avec quelle minutie tout le monde a disséqué ses œuvres, tout le respect et l’admiration qui émane de chacune des interventions. Je ne peux moi-même empêcher mes larmes de couler. Dis-moi d’en revenir, que je me trompe, que la personne que je pleure n’existe pas, que c’est un narrateur, un auteur modèle ou je ne sais trop. Je me sens illégitime d’être endeuillée, de pleurer le café que nous aurions pu boire ensemble, les livres que tu n’auras jamais écrits. Mais puisque je ne le saurai jamais, fais-moi rire. Fais-moi oublier que mon épicerie me coûte deux à trois fois plus cher en te foutant de la gueule du néolibéralisme. Fais-moi oublier que je suis en train de perdre la tête dans mes fictions en mettant en scène des étudiant·es déprimés. Fais-moi oublier qu’une fois les yeux fermés dans la douche, je pense à des façons de crasher mon char.
Avec François disparaît une choquante vérité qu’il avait le don de faire avaler avec humour. La dissonance entre l’être et le paraître. Ce décalage entre les paroles et les actions. Il jette sans vergogne la lumière sur la brutalité du quotidien en pointant les deux côtés irréconciliables d’une même médaille que tous·tes semblent docilement accepter. Ses personnages ratés et anti-productifs renvoient d’ailleurs à une image de soi qu’il sait dérangeante, à l’opposé du masque de perfection, de rentabilité et d’excellence que tous·tes devraient renvoyer à chaque instant.
Mon auteur préféré est mort. Vers qui dois-je me tourner quand je veux qu’on soit si honnête que ça me fesse comme une claque dans la face ? Ses livres ne me donneront plus l’espoir nécessaire pour affronter un monde beige et plat. Lui non plus n’y croyait pas vraiment.
La vie n’est pas un livre, parce qu’elle finit rarement bien. Mais elle en est peut-être un de François Blais. J’essaye, du moins, de naviguer à travers le quotidien avec le même affront que ses personnages, de profiter du fait que ma vie ait la même finalité que celle du marsouin ou de la crevette. M’en foutre plutôt que m’en faire. Et ça, pour moi, ça implique d’aborder la politique à table, comme le ferait ma famille, de parler d’argent, de soulever les non-dits, d’exprimer réellement ce que je pense et comment je me sens.
Quelque chose est mort en même temps que François Blais.
Biographie

Claudie Létourneau, lorsqu’elle ne lit pas un bon livre, entourée de ses animaux, s’interroge sur la vie et le quotidien. Entre l’écriture de son roman-feuilleton humoristique et magique sur Pavillons, son poste d’auxiliaire de recherche en littérature numérique pour Littérature québécoise mobile et la rédaction de son mémoire sur le cynisme dans les œuvres de François Blais, elle pense que s’il y a un sens à l’existence – ce qui ne peut être moins certain – il se trouve au bout de la truffe mouillée d’un chien ou entre deux bouchées d’un souper entre ami·es.
Notes
- François Blais, Iphigénie en Haute-Ville, Longueuil, L’instant même, 2009, p. 19. ↩︎
- Ibid., p. 19. ↩︎
- Dominic Tardif, « François Blais n’est pas désagréable », dans Lettres québécoises [en ligne] https://lettresquebecoises.qc.ca/index.php/fr/article-de-la-revue/francois-blais-nest-pas-desagreable (Page consultée le 8 septembre 2023).
↩︎ - François Blais fait une apparition dans son roman Sam. Je ne suis pas si loin de la réalité.
↩︎ - Patrick Douville, « Le mystère François Blais », dans La Fabrique culturelle [en ligne] https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10720/le-mystere-francois-blais (Page consultée le 20 août 2023).
↩︎ - François Blais, Iphigénie en Haute-Ville, Longueuil, L’instant même, 2009, p. 145-146.
↩︎ - Michel Onfray, « Incipit comoedia », dans Cynismes, op. cit., p. 26. ↩︎
- François Blais, Iphigénie en Haute-Ville, Longueuil, L’instant même, 2009, p. 162. ↩︎